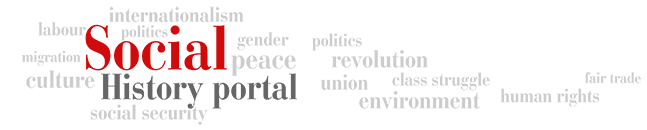| Summary: | DEIS = Diplôme d'État d'ingénierie sociale
La République sociale, née de la Révolution française, est conceptualisée par les révolutionnaires de 1848 lors de la rédaction de la Constitution de la IIe République. Cette notion novatrice, mise en sommeil pendant près d'un siècle, sera reprise par les constituants de 1946 dans le Préambule de la IVe République, « Tout être humain, qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » Depuis, la solidarité nationale, fruit de la République sociale, a été intégrée dans le bloc de constitutionnalité de la Ve République. À partir des années 1980, la France a mis en place un processus de décentralisation qui a touché l'aide et l'action sociale, et dans une moindre mesure la protection sociale, réalités tangibles de la solidarité nationale. Notre interrogation est alors la suivante : comment un État peut-il être garant de la solidarité nationale et décentralisé dans son organisation ? Il pourrait donc exister une tension entre la notion de solidarité nationale d'une part et la décentralisation de l'aide sociale d'autre part ? Le choix méthodologique s'est porté sur l'observation documentaire : textes à portée constitutionnelle depuis 1789 et statistiques diverses émanant principalement de l'Insee, la Drees et de la bdsl. Après une étude des textes constitutionnels placée sous les prismes de la solidarité, de l'égalité et du territoire, une analyse des politiques sociales met en évidence l'importance de la solidarité nationale à travers l'existence des minima sociaux. C'est par le biais du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et de son volet insertion que nous avons étudié la possible existence de la tension entre solidarité nationale et décentralisation des politiques sociales. L'étude porte sur un vaste ensemble de paramètres socio-économiques départementaux : population totale, chômeurs et taux de chômage, Allocataires et bénéficiaires du RMI, dépenses d'insertion dans le cadre du RMI, budget d'aide sociale départementale, secteurs d'activité, pauvreté. La conclusion réinterroge le binôme Politiques sociales/Égalité, à l'aulne de la Constitution de la Ve République et propose des scénarios pour une ingénierie sociale plus soucieuse de la Solidarité nationale au XXIe siècle.
|
|---|