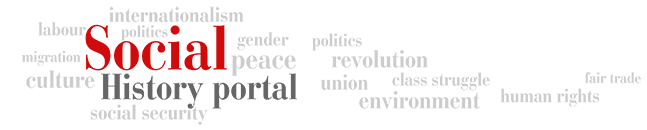| Summary: | DSTS = Diplôme supérieur en travail social
En France, coexistent plusieurs modes d'éducation pour jeunes sourds au sein de différentes écoles ou institutions spécialisées ou non. Les méthodes d'enseignement sont elles-mêmes diversifiées entre l'oralisme et le gestualisme. La question est de savoir si les jeunes sourds scolarisés dans les écoles spécialisées sont suffisamment préparés pour s'intégrer dans la société d'entendants ou bien s'ils ressentent le besoin ou la nécessité de se regrouper pour s'entraider ? Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'intégration des jeunes handicapés dans les écoles ordinaires de leur quartier est devenue la règle. Mais, quelles incidences auront ces nouvelles réformes pour la socialisation des jeunes sourds et pour la pérennité des associations de sourds participant activement à l'existence de la communauté des sourds ? Nous nous interrogeons sur l'existence de facteurs particuliers intervenant dans le processus de socialisation des enfants sourds scolarisés dans les écoles spécialisées qui favoriseraient, une fois adultes, leur regroupement au sein de la communauté sourde. Notre travail de recherche nous a amené à explorer l'évolution de la législation française concernant la personne handicapée et à aborder l'histoire de la prise en charge sociale et éducative de la personne sourde afin de cerner des facteurs particuliers qui concourent à sa socialisation spécifique. L'existence de la langue des signes et les valeurs qu'elle véhicule nous on permis de mieux situer le modèle culturel propre aux personnes sourdes. Les travaux de Ralph Linton et Robert K. Merton, sur les notions de culture et de socialisation, nous ont permis d'appréhender ces concepts dans le sens qu'existent autant de cultures et de socialisations qu'existent des groupes spécifiques, différents, partageant une langue et/ou des valeurs communes. L'évolution législative en matière d'intégration dans le milieu ordinaire pour les enfants sourds se doit de prendre en compte leur spécificité d'être en relation au monde. Des aménagements doivent s'opérer afin de garantir une prise en charge éducative respectant les personnes sourdes : leur expression et leur perception par un mode visiogestuel et leur nécessité de se regrouper. Nous avons mené notre enquête de terrain par des entretiens semi directifs, en présence d'un interprète, auprès de six adultes sourds de naissance, ou dont la surdité est survenue avant l'acquisition du langage, issus de parents entendants et ayant vécu en totalité ou en partie leur scolarité en écoles spécialisées pour jeunes sourds. Notre enquête révèle l'importance de la langue des signes dans la socialisation des jeunes sourds durant leur scolarité en école spécialisée ; du rôle mené par les associations pour sourds permettant de retrouver des facteurs culturels rencontrés dans ce type d'école. Ces associations sont le lieu où s'exprime et perdure la communauté sourde. Les nouvelles règles législatives en matière d'intégration en milieu ordinaire génèrent des craintes pour les adultes sourds interviewés face au manque de moyens alloués actuellement dans le système éducatif français. Des évolutions dans nos pratiques professionnelles sont nécessaires si l'on veut que les personnes sourdes puissent garder leur singularité, leur langue gestuelle comme véritable moyen de 145 communication et les liens qui les rassemblent au sein de la communauté des sourds.
|
|---|