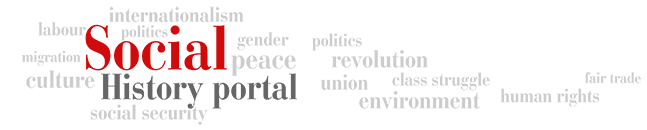af015115: L'Irak, guerre civile ou conflit régional ?
"Affiche van Simonis-Design uitgegeven in 2007 door Le Soir tegen de Irakoorlog. Afbeelding: kaart van Irak; portretfotootje van Muqtada al-Sadr; kleurenfotootje van een militair; kleurenfotootje van Ba’athisten en nationalisten; kleurenfotootjes van een jihadstrijder; portretfotootje van Paul...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Institution: | Amsab-Institute of Social History |
| Format: | IMAGE |
| Published: |
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/10796/2E33B060-FB36-4D2B-8A7E-3CD82EF194C8 |
| Summary: | "Affiche van Simonis-Design uitgegeven in 2007 door Le Soir tegen de Irakoorlog. Afbeelding: kaart van Irak; portretfotootje van Muqtada al-Sadr; kleurenfotootje van een militair; kleurenfotootje van Ba’athisten en nationalisten; kleurenfotootjes van een jihadstrijder; portretfotootje van Paul Bremer; portretfotootje van Saddam Hoessein; kleurenfotootje van de botsingen in Najaf tussen Amerikaanse troepen en de radicale sjiitische militie van Muqtada al-Sadr; kleurenfotootje van het grote Amerikaanse offensief tegen soennitische opstandelingen in Fallujah; portretfotootje van Jalal Talabani; portretfotootje van Nouri Maliki. Tekst: 16 cartes Le monde en crises. 4 L’Irak, guerre civile ou conflit régional ? L’invasion et l’occupation américaine de l’Irak ont ravivé les haines religieuses et ethniques, et le ressentiment face au déséquilibre géographique des ressources naturelles. L’instabilité du pays, qui abrite les troisièmes réserves de pétrole au monde, affecte la stabilité du Moyen-Orient tout entier. LA SITUATION SÉCURITAIRE. La situation sécuritaire évolue en permanence, selon des considérations militaires variées. La cruauté des djihadistes les a amplement coupés des soutiens dont ils bénéficiaient au début auprès de la population sunnite. Ils subissent aussi une offensive en règle des Américains dans la capitale cette année. Mais leur capacité de nuire demeure importante, principalement à Bagdad et aussi au nord de la ville. Les opposants à l’occupation continuent à faire peser une menace contre les Américains et contre l’armée officielle. Au Nord, les Kurdes bénéficient d’une autonomie avancée et les « peshmergas », leur armée, maintiennent l’ordre avec efficacité. Au sud, des milices chiites rivales s’affrontent sporadiquement, notamment dans la grande métropole Bassora. ARABIE SAOUDITE. Le régime conservateur de la famille Saoud, allié des Etats-Unis, ne peut s’empêcher, comme foyer de l’islam – « protecteur des lieux saints » - et du sunnisme, de critiquer ce que le roi Abdallah appelle « l’occupation » de l’Irak. Des extrémistes saoudiens profitent par ailleurs d’une frontière longue et poreuse pour renforcer les djihadistes en Irak. JORDANIE. Son régime pro-occidental est devenu l’une des destinations principales pour les réfugiés irakiens, souvent des sunnites, qui seraient environ un million dans ce pays. Une lourde charge pour la Jordanie même si une partie des irakiens, souvent des membres de l’élite sous Saddam Hussein, sont arrivés avec leurs économies et leurs compétences. SYRIE. Près de deux millions de réfugiés irakiens y sont arrivés ces dernières années, un poids considérable pour l’économie locale déjà fragile. Le régime syrien est par ailleurs accusé par les États-Unis de favoriser le passage de candidats terroristes vers l’Irak, ce qu’il nie. TURQUIE. Membre de l’Otan, la Turquie voit d’un mauvais œil les velléités autonomistes, voire séparatistes des Kurdes irakiens : une partie des Kurdes turcs sont eux-mêmes en rupture, la guérilla du PKK trouvant souvent refuge d’ailleurs en Irak au grand dam de l’armée turque. IRAN. Accusé par les États-Unis de favoriser la rébellion dans l’Irak chiite, l’Iran n’en entretient pas moins des rapports plutôt bons avec les chiites majoritaires au parlement et au gouvernement : souvent, ces élus ont passé des années d’exil à Téhéran sous l’ère de Saddam Hussein, persécuteur des chiites (et des Kurdes), grand ennemi de la république islamique d’Iran. Triangle sunnite. Le cœur du pays sunnite, foyer du régime laïque et dictatorial de Saddam Hussein, le « triangle sunnite » ou « triangle de la peur » incarna la résistance à l’occupation américaine après l’invasion de 2003. La province Anbar, seule entité sunnite homogène du pays, est désormais un peu moins récalcitrante : les excès des djihadistes ont poussé les chefs de tribus à composer cette année le pourvoir central, avec les Américains. KOWEÏT. Petit émirat pétrolier, le Koweït a vu avec soulagement la fin de Saddam Hussein, qui avait envahi son pays en 1990. L’émirat sunnite observe avec inquiétude l’évolution de la situation intérieure en Irak. Les insurgés. Armée du Mahdi. La milice créé par le jeune imam chiite Moqtada al-Sadr, très populaire auprès des masses déshéritées ; radical et anti-américain, Sadr ne combat pas ouvertement les Américains mais les clashes sont fréquents. Sadr a suspendu ses activités le 28 août 2007. Escadrons de la mort. Selon de nombreux sunnites, il existe des escadrons de la mort, émanation des forces de sécurité officielles dominées par les chiites. Ils seraient responsables des exécutions sommaires de sunnites, principalement à Bagdad. Baassistes et/ou nationalistes. Les partisans de l’ancien régime du parti Baas et d’autres Irakiens simplement nationalistes, refusant l’occupation américaine et britannique, forment l’essentiel des forces qui combattent les soldats étrangers et l’armée officielle. Djihadistes. Venus pour partie, voire majoritairement, de l’étranger, du monde arabo-musulman, des milliers d’islamistes radicaux sunnites se pressent en Irak pour combattre « les croisés » et aussi les chiites, accusés d’hérésie et de complicité avec l’occupent. La mouvance Al-Qaïda occuperait une place prépondérante parmi ces activistes qui n’hésitent pas à envoyer des bombes humaines sur les marchés pour attiser les haines et faire basculer la pays dans la guerre civile. 20 mars 2003. Les Etats-Unis entament la guerre contre l’Irak de Saddam par des tirs de missiles US. Quelques jours plus tard, les troupes américaines et britanniques entrent en Irak par le sud. Mai 2003. Paul Bremer, nommé administrateur américain en Irak, abolit le parti Baas et les institutions du régime déchu, et dissout l’armée. 19 août 2003. Attentat contre le quartier général de l’ONU à Bagdad, 23 tués, dont le représentant de l’ONU Sergio Vieira de Melho. 14 décembre 2003. Saddam Hussein est capturé à Tikrit. Mars 2004. Un attentat suicide tue 140 personnes lors d’un festival chiite à Karbala et à Bagdad. Juin 2004. Les États-Unis octroient la souveraineté à un gouvernement intérimaire, dirigé par Lyad Allawi. Août 2004. Affrontements à Nadjaf entre les forces US et la milice chiite radicale de Moqtada Sadr. Novembre 2004. Offensive américaine de grande envergure contre les insurgés sunnites à Falloudja. 30 janvier 2005. Élections par les Irakiens d’une Assemblée nationale transitoire. L’Alliance chiite irakienne remporte la majorité des sièges, juste avant les partis kurdes. Avril 2005. Le Kurde Jalal Talabani (en photo) est élu président par le Parlement. Le chiite Ibrahim Jaafari est nommé Premier ministre. Octobre 2005. Les électeurs adoptent une nouvelle Constitution, qui consacre la création d’une démocratie fédérale islamique. 15 décembre 2005. Premières élections législatives depuis l’invasion américaine, remportées par l’Alliance chiite irakienne, mais sans majorité absolue. 22 avril 2006. Après 4 mois de blocage politique, le candidat chiite Nouri al-Maliki est invité à former un nouveau gouvernement. 7 juin 2006. Le chef d’Al-Qaïda en Irak, Abou Moussab al Zarqaoui, est tué par des tirs aériens. Novembre 2006. Saddam Hussein est reconnu coupable de crimes contre l’humanité et est condamné à mort. Une série d’attentats-suicides tue plus de 200 personnes à Sadr City, aile chiite de Bagdad. 6 décembre 2006. Un rapport du Groupe d’étude sur l’Irak (Iraq Study Group) émet des recommandations au président américain George Bush sur la politique irakienne et qualifie la situation de grave et délétère. 30 décembre 2006. Saddam Hussein est exécuté par pendaison. 10 janvier 2007. Le président américain George Bush annonce la mise en place d’une nouvelle stratégie en Irak, impliquant l’envoi de 28.000 soldats, notamment à Bagdad, pour renforcer la sécurité. 1er août 2007. Le Front irakien de la Concorde, bloc politique sunnite, se retire du gouvernement et provoque une crise en son sein. Des attentats à la voiture piégée frappent le villages kurdes yezidis et tuent 400 personnes au total. C’est l’attaque la plus meurtrière depuis 2003. LE SOIR. Réalisation Services Monde et Infographie du journal Le Soir, Simonis-design.be. Crédits : DR, EPA, Belga, AP, AFP. Sources : US DOD, Le Temps. 2007 © LE SOIR. FULL TEXT AVAILABLE AT AMSAB-ISH" |
|---|---|
| Physical Description: | papier geheel: hoogte, 42 cm geheel: breedte, 58 cm affiche |