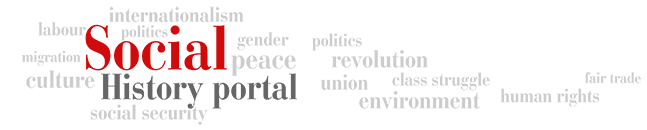| Summary: | DSTS = Diplôme supérieur en travail social
La place centrale et la permanence de la notion même de partenariat dans le travail social s'inscrivent dans un contexte particulier qui se caractérise par une évolution des politiques publiques. La manière d'aborder et de traiter les questions sociales depuis une vingtaine d'années remet en cause un traitement exclusivement catégoriel des populations au profit d'une approche plus territoriale et transversale. La maîtrise d'ouvrage qui était surtout assurée par l'Etat est de plus en plus partagée avec les collectivités territoriales et se traduit par la mise en place de dispositifs contractuels qui donne de plus en plus de poids à l'initiative locale. Les travailleurs sociaux sont de plus en plus amenés à agir de manière conjointe avec les nouveaux acteurs locaux, historiquement extérieurs au travail social. Cette réconfiguration des places et des rôles illustre bien la mise en marche d'une modernisation de l'action publique qui se traduit par l'impulsion de nouvelles méthodes managériales. C'est bien dans ce contexte que le partenariat se pose en solution mais aussi en problème lorsqu'il s'agit de faire coopérer, à l'échelle d'un territoire, des acteurs qui sont parfois loin d'avoir une conception homogène de l'action collective. Dans un contexte où le système d'acteurs et d'actions sont complexes, le partenariat dépasse la seule idée d'agir ensemble. Il véhicule des enjeux plus profonds qui conduisent à mettre en question le sens de l'action et la place des acteurs, leurs légitimités, leurs identités, leurs limites. A Châteauroux, sur le quartier St Jean, territoire au Contrat de Ville, quinze acteurs se rencontrent chaque mois pour essayer d'adapter leurs modes d'interventions à un enjeu de recherche de cohérence globale. L'enquête par entretiens de l'ensemble des acteurs concernés confirme par une série d'analyses thématiques que si une évolution des pratiques professionnelles est bien en marche, l'efficacité de l'action jointe reste encore relative. La tentative de produire du décloisonnement professionnel se traduit par une difficulté à coopérer efficacement en raison de logiques individuelles qui restent mal articulées les uns aux autres. La sociologie de la traduction donne des clés de compréhension et d'analyse qui peuvent se révéler utiles pour aider un chef de projet à créer un réseau d'acteurs à mobiliser dans une perspective de changement. L'opération visant à créer de la convergence entre les acteurs par les accords nouveaux qu'ils peuvent passer entre eux peut être facilitée en prenant en compte des préconisations données par cette nouvelle sociologie des organisations.
|
|---|