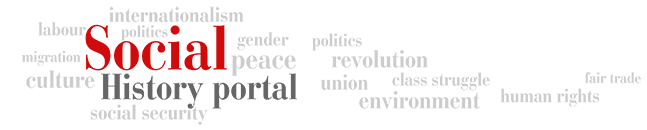| Summary: | DEIS = Diplôme d'État d'ingénierie sociale
Dans le discours politico médiatique, la parentalité dans les territoires défavorisés tend à être considérée comme représentative des dysfonctions parentales, qui s'inscrivent comme un des principaux facteurs de la crise des valeurs qui touche la société contemporaine. Le modèle construit sur la notion de compétence par les politiques publiques à partir d'un travail de catégorisation indique le mouvement de déplacement des responsabilités familiales. Les parents portent désormais la responsabilité des difficultés rencontrées, au mépris de l'évidente importance des désavantages ou des inégalités sociales et/ou économiques. Placé au cur des préoccupations de la politique publique, le débat sur la parentalité et surtout sur les formes de réponses à apporter pour solutionner le ou les problèmes se polarise autour de deux positions : faut-il soutenir ou sanctionner les parents ? La controverse est marquée par la participation réduite, voire l'absence totale des intéressés dans les échanges les concernant, soulignant à propos les dires de Pierre Bourdieu « les quartiers parlent moins qu'ils ne sont parlés ». Ce trait significatif a donné forme à l'approche avec laquelle a été menée la réflexion soumise ici. Dans la perspective d'une meilleure compréhension dans les relations entre les familles et les professionnels, le présent développement propose, à partir d'une enquête réalisée sous forme d'interviews de parents qui résident dans un quartier dit sensible, une analyse visant à comprendre sur quoi sont construits les rôles et l'identité parentale. Partant du postulat que le contexte de la géographie prioritaire contribue à structurer les manières d'être et de se sentir parent, la démonstration interroge les relations entre les logiques de l'acteur et les contraintes propres au lieu de résidence.
|
|---|