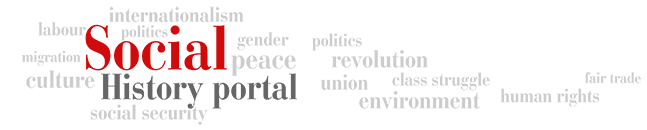| Summary: | N° spécial de : "Agone", n° 22, 1999
Sommaire Éditorial. Capitalisme & démocratie On joue mieux avec un ballon gonflé, François-Xavier Verschave Il sagit de faire servir lÉtat plutôt quil ne se serve , de lobliger, un peu contre sa nature, à produire du service public, plutôt quà généraliser le « self-service public »
Vaste programme, vaste enjeu politique. LÉtat na que sa triste raison et de conscience que celle de ses citoyens. À encenser le rôle de lÉtat, à lui abandonner le soin du développement humain, on nencourage pas à cultiver une large « société civile », capable de résister aux illusions célestes
En réalité, la communication entre gouvernants et gouvernés relève dune poésie, ou dune pneumatique, qui restent largement à inventer. Droit de détresse & appropriation sociale, Daniel Bensaïd La défense des principes du service public, la question du « bien commun » et les débats sur la protection sociale et les fonds de pension impliquent un élargissement de lespace public au lieu de sa privatisation. Oui, les banques, les assurances doivent être des leviers de politiques publiques. Oui, les compagnies des eaux, de lénergie, des transports, des communications doivent être socialisées pour garantir par la péréquation tarifaire un service de qualité égale à prix égal pour toutes et tous et pour conduire une politique de développement durable. Oui, la subordination de léconomie à la citoyenneté, de lintérêt privé à lintérêt général, des profits aux besoins collectifs implique toujours une démocratie participative den bas, du contrôle populaire et de lautogestion. Ni capitalisme, ni collectivisme. Recension de The Road to Serfdom de F. A. Hayek & de The Mirror of the Past de I. R. Zilliacus, George Orwell La confrontation de ces deux ouvrages résume bien la situation dramatique où nous nous trouvons à présent. Le capitalisme conduit à des files dattente devant les bureaux dassistance publique, à la lutte acharnée pour les marchés et à la guerre. Le collectivisme conduit aux camps de concentration, au culte du chef et à la guerre. Il ny a pas dissue à ce dilemme, à moins quon ne parvienne à combiner une économie planifiée avec la liberté de pensée. Lavenir de lillusion capitaliste. Dun mensonge « déconcertant » à lautre (II), Michel Barrillon Il est possible que le capitalisme sécroule sous le coup, non de ses contradictions internes, mais de sa trop grande réussite ; quil meure d« une grande solitude de lesprit » (Seattle), du désenchantement quil nourrit, de sa nécrophilie (Fromm), de sa haine de la vie dans son exubérance spontanée et dans « les plaisirs [gratuits] de la rencontre, de lamour, de lamitié, de lart, du savoir, de la création, de la tendresse » (Vaneigem). Sil doit disparaître, quil en soit ainsi ! Cependant, si lon veut éviter que son implosion ne précipite lhumanité dans des expériences sociales et politiques non moins catastrophiques, il faut impérativement faire renaître un mouvement autonome radical, porteur dune utopie émancipatrice réactualisée radical parce que lhistoire montre que le système capitaliste est capable de phagocyter tous les projets qui ne le mettent pas en cause dans ses fondements. Sauver le capitalisme ou se sauver du capitalisme ? En finir avec le mythe du productivisme, Jacques Luzi Le discernement de Keynes, en tant que penseur bourgeois, fut une exception. Les hommes ne mourront pas toujours calmement, prévenait-il, craignant que la « détresse » conduise le « peuple de l abîme » (Jack London) à «écraser la civilisation » capitaliste
Dans sa grande majorité, la bourgeoisie, incapable de rester maître de son avidité et de sa vanité, ne sest pas montrée aussi savante et clairvoyante que Keynes laurait souhaité. « Le dirigisme a de tout temps suscité une vive opposition » de la part de « lidéologie du laisser-faire », alors même que « la politique du gouvernement [restait] conforme aux intérêts du capital. » Il en est toujours de même. Il ny a aucune raison pour que cela cesse
Dans les conflits, la position ultra-libérale est dune clarté exemplaire : « Non seulement la liberté na rien à voir avec une quelconque égalité prévient Hayek , mais elle est susceptible de produire inévitablement plusieurs formes dinégalité. » Difficile légitimation dÉtats en perte de vitesse, Jean-Philippe Melchior Le désarroi des habitants est à la mesure de limpuissance des élus locaux. Même lorsquils se disent libéraux, ceux-ci attendent de lÉtat une aide immédiate pour gérer le coût social des licenciements. Tandis quils nespèrent que dans lÉtat pour initier une politique capable de favoriser la création demplois. Nous voici revenus à la case départ. Peut-on attendre de lÉtat une politique volontaire dans les domaines économique et social au moment où il renonce, à la faveur de lintégration européenne, à lessentiel de ses prérogatives ? Lesprit antidémocratique des fondateurs de la « démocratie » moderne, Francis Dupuis-Déri Se réclamant de la « démocratie » sans toutefois donner plus de pouvoir au démos , les représentants de nos systèmes politiques nont pas seulement piégé le peuple quils prétendaient servir, cest la langue elle-même quils ont trahie : comment désormais mettre à jour lanti-démocratisme des discours, des pratiques, des systèmes et des hommes politiques rangés sous létiquette de « démocrates » ? Le glissement de sens qua connu le mot « démocratie » constitue sans doute le principal coup de maître de la propagande politique moderne. Élection, tirage au sort & démocratie. À propos des Principes du gouvernement représentatif de Bernard Manin, Alain Arnaud La question nest pas seulement de démontrer le caractère nécessairement inégalitaire de lélection mais de savoir jusquà quel degré un système de désignation des représentants pourrait être égalitaire tout en restant compatible avec une société dont le fonctionnement est structuré par linégalité. La sphère politique ne se laisse donc pas dissocier des structures sociales et du contexte historique. Il est troublant quon ne trouve rien chez Manin sur linfluence de lindividualisme de la société marchande ou de la mondialisation sur le rapport du citoyen à la représentation de la communauté politique. Le sentiment de crise nest-il pas présent là encore lorsque lindividu ne perçoit plus lÉtat comme instance exclusive et suprême de gouvernance ? Mondialisation de la « tolérance zéro », Loïc Wacquant «À New York, nous savons où est lennemi », déclarait William Bratton, le nouveau Chef de la police de New York
En loccurrence : les « squeegee men », ces sans-abri qui accostent les automobilistes aux feux pour leur proposer de laver leur pare-brise contre menue monnaie, (Giuliani avait fait deux le symbole honni du déclin social et moral de la ville lors de sa campagne électorale victorieuse de 1993, et la presse populaire les assimile ouvertement à de la vermine : « squeegee pests »), les petits revendeurs de drogue, les prostituées, les mendiants, les vagabonds et les graffiteurs. Bref, le sous-prolétariat que cible en priorité la politique de « tolérance zéro » dont lobjectif affiché est de rétablir la « qualité de la vie » des New-Yorkais qui savent, eux, se comporter en public, cest-à-dire des classes moyennes et supérieures, celles qui votent encore. LÉcole du Capitalisme total, Jean-Claude Michéa Le mouvement qui, depuis trente ans, transforme lÉcole dans un sens toujours identique, peut maintenant être saisi dans sa triste vérité historique. Sous la double invocation dune « démocratisation de lenseignement » (ici un mensonge absolu) et de la « nécessaire adaptation au monde moderne » (ici une demi-vérité), ce qui se met effectivement en place à travers toutes ces réformes également mauvaises, cest lÉcole du Capitalisme total, cest-à-dire lune des bases logistiques décisives à partir desquelles les plus grandes firmes transnationales une fois achevé, dans ses grandes lignes, le processus de leur restructuration pourront conduire avec toute lefficacité voulue la guerre économique mondiale du XXI e siècle Libéralisme & démocratie : frères ennemis, Immanuel Wallerstein Quelles relations entretiennent libéraux et démocrates. Les premiers mettent en avant la défense de la compétence. Les autres, lurgente priorité du combat contre lexclusion. On souhaiterait pouvoir dire : pourquoi pas les deux à la fois ? Parce quil nest pas facile de mener les deux objectifs de front. La compétence, par définition, sous-entend lexclusion. Car sil y a compétence, il y a incompétence. Lintégration impose que chacun ait le même poids dans la vie collective. Au niveau gouvernemental comme dans la prise de décision politique, les deux objectifs entrent presque toujours, en conflit. Cest alors que les frères deviennent ennemis. FICTIONS & DICTIONS La Mort du héros, Andreas Latzko (Traduit de lallemand par M. Wachendorff & H.F. Blanc) Tous les mystères de la guerre, toutes les questions quil ruminait depuis des mois séclaircirent soudain : on rendait leurs têtes à ces hommes au moment de mourir. « Bientôt mort ? Très bien, tenez, voici votre tête. » Là-bas, à larrière, on démontait leurs têtes pour les remplacer par des disques jouant la marche de Rákóczy, on les empilait dans des trains et, comme le malheureux Meltzar, comme lui-même, comme tous, ils arrivaient au front la tête ailleurs
Communication à lAcadémie des sciences, Jovica Acin (Traduit du serbo-croate par Mireille Robin) Les Balkans nont pas existé ; ils ont été inventés pour que les hommes préhistoriques prennent conscience du caractère chaotique de leur existence. Les Balkans étaient comme une formule magique qui leur permettait de se remémorer leur passé, passé que nous ne devons pas forcément, Messieurs les académiciens, considérer comme ayant existé. Ils se souvenaient donc de leur passé et, grâce à des procédés magiques, littéraires, artistiques, préfiguraient lavenir quils allaient perdre. Si les Balkans étaient obligatoirement le sujet de toute création, ils nétaient pas pour autant celui de lhistoire de la création. Wladek, récit de Galicie, Andrzej Stasiuk Au cours de la distribution des âmes, il y eut certainement une erreur ; le corps de Wladek, modelé avec la glaise de ce sol, hérita dun esprit aérien, bien trop éthéré pour saccorder à la pesanteur. De ses propres membres, du sommeil, de lécoulement du temps, du poids de la glèbe pierreuse. Le rythme séculaire, qui poussait ses voisins au printemps dans les campagnes, en été dans les prés, et en automne dans les champs de pommes de terre, leffleurait à peine. Wladek, plutôt brave homme et buveur raisonnable, avait au village une mauvaise situation et il était sûrement celui qui gagnait le moins dargent. Il tentait de combler son manque de force par lingéniosité. MARGINALIA « La violence nest pas dans mes paroles mais dans les faits
». Lettre à La Révolution prolétarienne (1927), Boris Souvarine. Avant-propos de Charles Jacquier
|
|---|